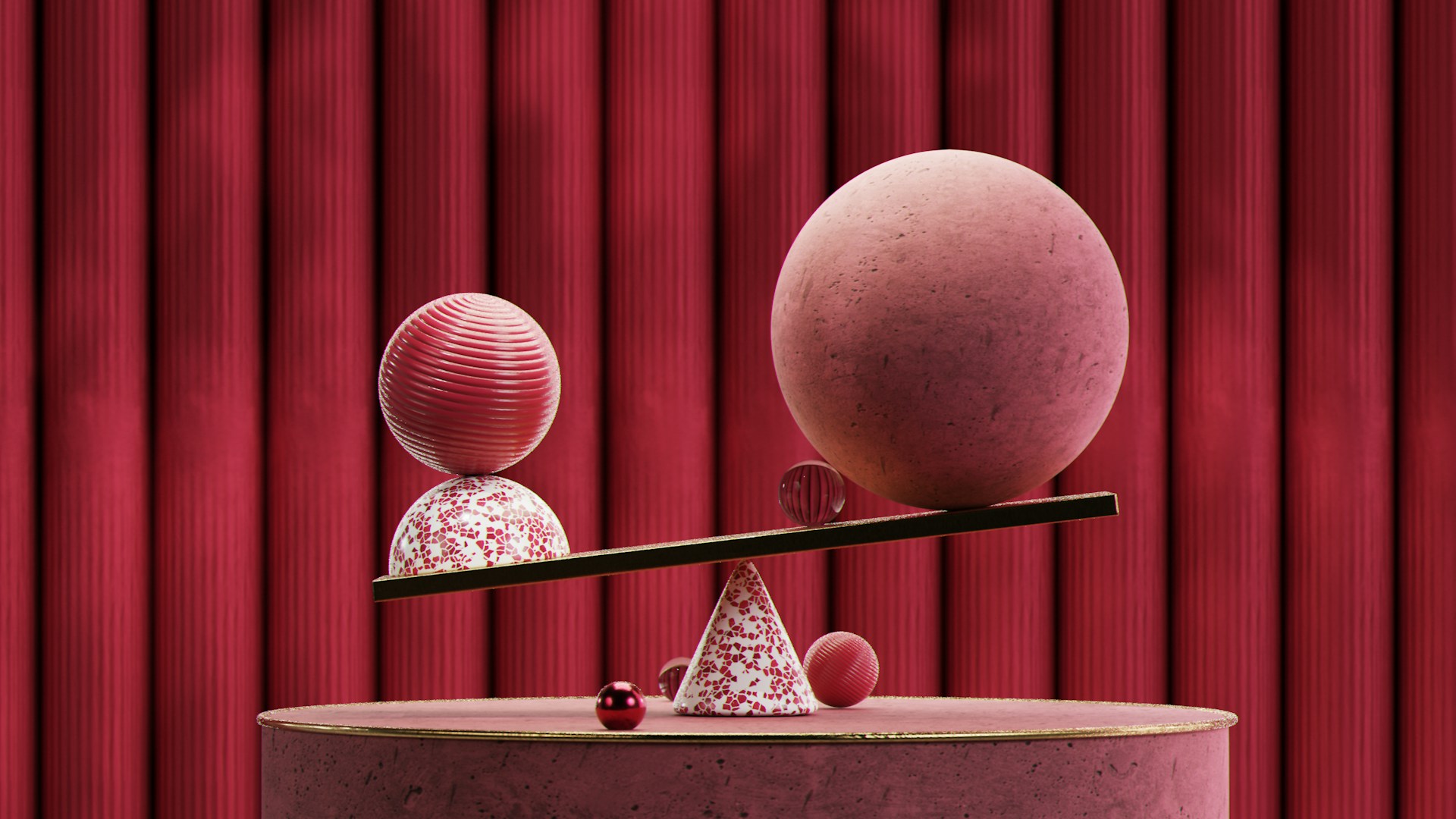25/02/2026
Situation relativement fréquente, celle du divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens laisse pour autant place, au stade de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, à des contentieux nourris, comme en témoigne l’arrêt ici commenté (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°24-12.796). Dans cette affaire, un […]